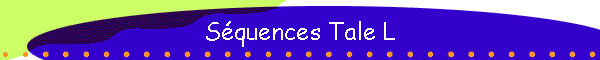Certaines zones de ce site sont encore en construction.
Merci de votre indulgence !



| | Présentation des séquences en cours de rédaction. Merci de patienter encore un peu ! Les lettres en Terminale LProgramme pour l'année 2006-2007 Réf. : arrêté du 20 juillet 2001 A - Grands modèles littéraires
(ainsi que les mythes qui peuvent s'y manifester) | - Antiques. | Œuvre : Les Métamorphoses d'Ovide (Livre X, Livre XI, Livre XII).
L'étude de ces trois livres sera accompagnée de la lecture complémentaire de quelques épisodes choisis librement par le professeur en fonction de leurs échos dans la littérature et les arts. Un document d'accompagnement est mis en ligne sur Eduscol, (http://www.eduscol.education.fr). | | - Français, du Moyen Âge à l'âge classique | | | - Européens. | | | B - Langage verbal et images | - Littérature et langages de l'image. | Œuvre : Contes de Charles Perrault illustrés par Gustave Doré : Grisélidis, Peau d'Âne, Les Souhaits ridicules, La Belle au bois dormant, Le Petit Chaperon rouge, La Barbe bleue, Le Maître Chat ou Le Chat botté, Les Fées, Cendrillon ou La Petite Pantoufle de vair, Riquet à la houppe, Le Petit Poucet. Une note d'accompagnement figure en annexe. | | - Littérature et cinéma. | | | C - Littérature et débat d'idées | - Œuvres et textes participant à un débat d'idées majeur dans l'histoire littéraire et culturelle. | Invention romanesque et débat philosophique Œuvre : Jacques le fataliste de Denis Diderot. | | D - Littérature contemporaine | - Œuvres contemporaines françaises ou de langue française. | Œuvre : Les Planches courbes de Yves Bonnefoy (Sections "Dans le leurre des mots", "La maison natale", "Les planches courbes" ).
L'étude de ces sections sera accompagnée de la lecture complémentaire de la section "La voix lointaine".
Un bref document suggérant quelques pistes d'étude est mis en ligne sur Eduscol
( http://www.eduscol.education.fr). http://www.eduscol.education.fr). | | - Œuvres étrangères (en traduction). | |
Annexe Pour l'étude des Contes de Perrault illustrés par Gustave Doré
Dans le cadre d'une entrée du programme intitulée "Langage verbal et images", il est entendu qu'aucune question à l'examen ne pourra porter sur une analyse de l'image qui ne viserait pas sa relation au texte. Il est rappelé en effet que l'objectif est de permettre aux élèves de réfléchir aux problèmes posés par les relations entre un texte littéraire et les choix opérés par un artiste qui, en imaginant de l'illustrer, crée sa propre œuvre.
Cette notion d'"illustration" appelle par elle- même une problématisation qui pourra se construire, au fur et à mesure des séances, dans une double direction, sensible et historique : on prendra en compte le retentissement et la fascination provoqués chez le lecteur par les images (ou "tableaux" ) de Gustave Doré, tout en replaçant celles-ci dans leur contexte, esthétique et éditorial, sans entrer dans des recherches spécialisées sur les graveurs, leurs techniques et le statut de leurs images dans la hiérarchie des genres.
On ne visera pas une analyse exhaustive de toutes les illustrations des Contes réalisées par Gustave Doré, et proposées sur divers sites. On s'attachera à confronter méthodiquement images et textes, en s'intéressant par exemple aux éléments narratifs et descriptifs qu'elles privilégient ou qu'elles omettent, au point de vue adopté par l'illustrateur, à la place assignée au spectateur, aux choix de mise en page, de composition, d'échelle, aux contrastes chromatiques, aux registres, aux publics visés, etc. Le programme est une invitation, en effet, à lire les Contes de Charles Perrault illustrés par Gustave Doré, et non à analyser comme une fin en soi la lecture que celui-ci en a suggérée.
Les Contes eux-mêmes s'inscrivent dans une histoire de la sensibilité, dans un contexte de débats littéraires et intellectuels qui en font des récits subtilement codés, emboîtant dans leur apparente limpidité plusieurs niveaux de sens. L'étude du texte de Perrault ne se limitera donc pas aux seuls éléments pris en compte par l'illustrateur, qui propose une lecture parmi d'autres possibles et qui n'a pas vocation à restituer l'ensemble des interprétations dont le texte littéraire est virtuellement porteur. BACCALAURÉAT
Épreuve de littérature du baccalauréat, série littéraire, à compter de la session 2003
NOR : MENE0201486N
RLR : 544-0a
NOTE DE SERVICE N°2002-140
DU 26-6-2002
MEN
DESCO A3
Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; au directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France ; aux inspectrices et inspecteurs pédagogiques régionaux ; aux proviseures et proviseurs ; aux professeures et professeurs
o Cette note de service fixe les modalités de l'épreuve de littérature du baccalauréat général de la série littéraire, applicables à compter de la session 2003 de l'examen. Les présentes dispositions annulent et remplacent les dispositions relatives aux épreuves de lettres, écrite obligatoire de série L et facultative de série ES, de la note de service n° 94-179 du 14 juin 1994 parue au B.O. n° 25 du 23 juin 1994.
Épreuve écrite obligatoire, série L
Durée : 2 heures
Coefficient : 4
Nature de l'épreuve
Les candidats ont le choix entre 2 sujets portant chacun sur un objet d'étude différent du programme de l'année.
Les sujets peuvent s'appuyer sur un texte littéraire ou critique, ou un document iconographique, pour engager la réflexion des candidats.
Les candidats sont invités à répondre, de façon construite et organisée, en deux développements successifs, à deux questions.
- La première question porte sur un aspect de l'œuvre retenue. En aucun cas, elle ne porte sur les œuvres recommandées en lecture complémentaire.
- La deuxième question porte sur l'ensemble de l'œuvre, en relation avec l'objet d'étude retenu.
Évaluation
L'évaluation se fondera sur les éléments suivants :
- la connaissance des œuvres et des objets d'étude au programme ;
- l'aptitude à prendre en compte des problématiques ;
- la clarté, la pertinence et la cohérence des propos ;
- la mise en œuvre de savoirs littéraires et culturels ;
- la justesse et la correction de l'expression.
Les libellés de sujets préciseront le barème accordé à chaque partie de l'épreuve.
Épreuve orale de contrôle, série L
Durée : 20 minutes
Temps de préparation : 20 minutes
Nature de l'épreuve
L'épreuve consiste en un exposé suivi d'un entretien.
Le candidat répond, dans un exposé organisé, à une question portant, soit sur un aspect d'une œuvre, soit sur l'ensemble d'une œuvre, en relation avec l' objet d'étude, soit sur un point de comparaison entre plusieurs œuvres inscrites au programme de l'année.
Au cours de l'entretien, l'examinateur, partant de l'exposé présenté par le candidat, invite celui-ci à préciser son propos, approfondir un commentaire ou une interprétation, à développer des perspectives. L'entretien pourra également prendre en compte les œuvres lues en lecture complémentaire pendant l'année.
Évaluation
L'évaluation se fondera sur les éléments suivants :
- la connaissance des œuvres et des objets d'étude du programme ;
- l'aptitude à prendre en compte des problématiques ;
- la clarté, la pertinence et la cohérence des propos, l'utilisation des notes personnelles ;
- la personnalité de l'interprétation et du jugement critique ;
- l'aptitude au dialogue et à l'échange ;
- la justesse et la correction de l'expression. PROGRAMME DE L'ENSEIGNEMENT DE LITTÉRATURE EN CLASSE TERMINALE DE LA SÉRIE LITTÉRAIRE
A. du 20-7-2001. JO du 4-8-2001
[...] ANNEXE
LITTÉRATURE
CLASSE TERMINALE DE LA SÉRIE LITTÉRAIRE
I - FINALITÉS
I.1 L'enseignement de littérature en classe terminale poursuit les objectifs et les finalités de l'enseignement du français en classe de seconde et en classe de première et renforce la spécificité de la série littéraire. Il a donc pour finalité propre de former la pensée par une forte culture littéraire et de donner les connaissances appropriées. Un accent particulier est mis ici sur les contenus ouverts tant sur le passé que sur l'immédiat contemporain, tant dans le domaine français qu'étranger. Il reprend les perspectives d'étude mises en œuvre les années précédentes. Il prend aussi en compte la réflexion sur la langue et la maîtrise de l'expression orale et écrite.
I.2 Cet enseignement constitue, grâce au nouvel horaire, un élément fort de l'originalité de la série littéraire. Il doit représenter un apport spécifique pour les élèves désireux de poursuivre des études supérieures dans le domaine des lettres et des arts, mais aussi des sciences humaines et du droit, des études politiques et des études commerciales.
I.3 Il s'agit donc de former des lecteurs avertis, et dans toute la mesure du possible, des liseurs, ainsi que des adultes capables de s'exprimer avec précision et aisance à l'oral comme à l'écrit. Dans un monde où les discours sont de plus en plus techniques, complexes et médiatisés, il est essentiel de donner aux élèves les moyens d'une analyse critique, d'une maîtrise raisonnée et d'une mise en œuvre lucide des discours, de la langue et des langages. L'enseignement de littérature contribue ainsi à la formation personnelle et citoyenne. Il permet aussi un dialogue cohérent avec les autres disciplines enseignées dans la série, en particulier la philosophie et l'histoire, ainsi que les options arts, théâtre et cinéma. Il offre des liens avec les TPE, par ses finalités, ses perspectives d'étude et ses contenus.
II - OBJECTIFS
II.1 La formation du jugement
L'enseignement de littérature en terminale littéraire complète les perspectives d'études déjà mises en œuvre :
- il développe la capacité de comprendre et interpréter les textes selon leurs formes et leurs contextes (étude des genres et de l'histoire littéraire) ;
- il développe la capacité de saisir et d'apprécier l'originalité des œuvres, en donnant des éléments de comparaison nombreux et diversifiés ; il forme donc le jugement critique ;
- il enrichit la faculté d'argumenter, de délibérer, en même temps que celle d'analyser de façon critique toutes les formes de l'argumentation ;
- il enrichit la perception des affects humains tels qu'ils se manifestent dans et par la littérature et les arts et fait saisir leur relation avec les mythes ;
- il approfondit l'analyse des relations entre la littérature et l'image.
II.2 Les connaissances
Les objectifs en ce domaine sont d'élargir la culture des élèves en abordant des domaines qui n'ont pas toujours été étudiés dans les classes antérieures (ou qui y ont été seulement abordés) et de les initier à la diversité des approches critiques.
L'ouverture à une culture plus large peut être d'ordre temporel (texte anciens, médiévaux, ou au contraire, textes de l'immédiat contemporain), générique (notamment pour les aspects textuels et littéraires du débat d'idées), langagier (relations entre littérature et image, cinéma).
La première littéraire a donné aux élèves la connaissance des scansions majeures de l'histoire littéraire ; l'enseignement de littérature en classe terminale doit compléter celle-ci.
Le travail sur la langue portera principalement sur les moyens de l'abstraction et de la conceptualisation, en relation avec le travail effectué en philosophie.
II.3 L'expression écrite et orale
Au cours de l'année, les élèves sont amenés à reprendre et approfondir les formes d'expression travaillées jusque là, tant écrites qu'orales (réactions à des lectures, lectures analytiques, débats, exposés, etc. ; écritures de commentaire, écritures de dissertation, écritures documentaires, écritures d'invention) afin de maîtriser les compétences suivantes :
- exposer par oral et par écrit l'interprétation d'un texte ;
- exposer par oral et par écrit un jugement argumenté ;
- rédiger un compte-rendu de lecture ou de recherche ;
- concevoir des projets d'écriture.
III - CONTENUS
Les compétences et les connaissances ci-dessus appellent des études portant sur :
- les grands modèles littéraires - sources culturelles -, y compris l'approche des mythes fondamentaux dans la littérature ;
- les langages, en particulier dans la relation du verbal et de l'image ;
- la littérature dans le débat d'idées ;
- la littérature contemporaine.
Les objets d'étude correspondants se répartissent donc dans les domaines suivants :
A - Grands modèles littéraires
(ainsi que les mythes qui peuvent s'y manifester) | - Antiques. | | - Français, du Moyen Âge à l'âge classique | | - Européens. | | B - Langage verbal et images | - Littérature et langages de l'image. | | - Littérature et cinéma. | | C - Littérature et débat d'idées | - Œuvres et textes participant à un débat d'idées majeur dans l'histoire littéraire et culturelle. | | D - Littérature contemporaine | - Œuvres contemporaines françaises ou de langue française. | | - Œuvres étrangères (en traduction). |
IV - MISE EN ŒUVRE : MODALITÉ D'APPLICATION
L'enseignement de littérature en classe terminale repose sur un programme révisable périodiquement. Tous les objets d'étude ci-dessus y sont mis en œuvre, à tour de rôle. Quatre sont prescrits chaque année, le renouvellement se faisant par quart ou moitié, selon la difficulté des œuvres concernées.
Les objets d'étude ainsi prescrits sont représentés par des œuvres choisies pour leur importance et leur représentativité. Le texte annuel d'application précise de façon explicite le domaine de connaissance et l'objet d'étude correspondant aux œuvre à analyser ; il indique d'autres œuvres ou catégories d'œuvres dont la lecture doit contribuer à compléter et enrichir les connaissances des élèves et leur permettre de contextualiser et mettre en perspective les œuvres étudiées.
Les œuvres choisies pour l'application du programme seront réparties de façon à assurer chaque année la présence au moins :
- d'une œuvre du passé et d'une œuvre contemporaine ;
- d'une étude touchant au langage de l'image ;
- d'un mythe majeur, antique (par exemple : les Atrides, Œdipe...) ou moderne (par exemple : Don Juan, Faust...).
N.B. : ces critères peuvent se combiner.
L'évaluation portera sur des connaissances précises, clairement rattachées aux perspectives et objets d'étude, et tiendra compte aussi des lectures complémentaires.YB |